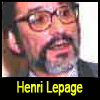Ces notes ont été rédigées il y a plusieurs mois (juin 1998). Elles ne prétendent pas couvrir tout le champ de ce qu’il y aurait à dire sur la famille, encore moins à propos du PACS. Elles sont faites pour attirer l’attention sur une autre problématique d’approche. Le besoin de légiférer sur la famille n’est bien souvent, comme dans d’autres domaines, qu’une conséquence de la nécessité de mitiger, voire redresser les effets pervers, socialement déstructurants, de législations antérieures. Par exemple en matière de droit successoral ou de fiscalité des ménages. Mieux vaudrait peut-être commencer par corriger ce qui ne va pas en amont, avant de bricoler sur une institution aussi fondamentale. La première note résume le contenu d’un livre publié aux Etats-Unis par une fondation libérale de la côte ouest des Etats- Unis, le Pacific Institute. La seconde a été écrite en réaction à la lecture d’une note de travail exprimant un point de vue favorable à une législation « pro-familiale ». Tout commentaire, ou même contestation seront les bienvenus.
Ce livre (« The American Family and the State », par Joseph Peden et Fred Glahe, Pacific Institute, 1986) fait apparaître une approche de la politique familiale fort différente de la manière dont ce sujet est abordé en France. Par exemple, il n’y a aucun chapitre concernant les rapports entre politique familiale et démographie (natalité). C’est une dimension qui n’est pas présente, ni même évoquée. Le Pacific Institute est un institut libéral. L’objectif du livre est de définir la limite des rapports entre l’Etat et la Famille : quel est le type d’encadrement juridique et réglementaire - jusqu’où ? - compatible avec le fonctionnement d’une société de liberté et de responsabilité ? On n’y trouve pas de réponse explicite. Quatre axes thématiques apparaissent cependant clairement :
1
1.Il existe une antinomie profonde, voire une hostilité de principe, entre les deux institutions sociales que sont l’Etat et la Famille. La famille est le lieu de la reproduction génétique, mais aussi intellectuelle et morale. C’est elle qui forme les enfants, et conditionne leurs modes de pensée. C’est le lieu de reproduction par excellence des inégalités (héritage), ou de leurs causes (différences d’éducation, différentiations sociales) - donc un lieu où la liberté risque d’entraver les mécanismes de socialisation dont l’Etat se proclame le garant. Bien des interventions faites au nom de la famille visent fondamentalement à transférer vers des administrations publiques la charge de fonctions qui ne sont plus (ou mal) assumées par certaines familles, mais dans le cadre d’un processus de marché politique qui conduit progressivement à universaliser cette politique de prise en main plus ou moins à toutes les familles (rôle des groupes de pression idéologico-bureaucratiques).
2.Les politiques de la famille ne sont le plus souvent qu’un faux-nez de l’Etat-providence. Elles ne sont qu’une modalité de la politique de redistribution. C’est beaucoup plus apparent dans le cas américain - où la dimension nataliste n’est pas présente - que dans le cas français. Mais c’est simplement une question de degré et non de nature. Un regard rapide sur le dernier rapport communiqué à Lionel Jospin (Juin 1998) montre qu’ici aussi le problème de la politique de la famille est de plus en plus abordé sous l’angle de la manière dont la pauvreté empêche certaines familles de jouer pleinement leur rôle social, et donc d’y remédier. La politique de la famille n’est donc qu’un aspect, un sous-chapitre de la politique de transferts sociaux. A ce titre, elle appelle les mêmes questionnements : sur son efficacité (ou inefficacité); sur ses « effets pervers » (ne s’agit-il pas de politiques et réglementations qui, en définitive, parce que déduites d’un mode de représentation angélique de l’Etat, entretiennent - et même développent - la pauvreté qu’elles doivent en principe réduire, et donc accentuent indirectement le déclin de l’institution familiale ?)
3.La crise de la famille en tant qu’institution sociale est un produit de la mode des mécanismes de régulation économique étato-keynésiens. Les symptômes de cette crise - l’explosion du nombre des divorces, la montée du nombre des familles monoparentales, le fait que de plus en plus d’enfants sont ainsi exposés à des conditions de pauvreté matérielle ou psychologique qui affectent leur avenir - sont liés aux stress de la société d’inflation, ainsi qu’aux effets pervers de la croissance des transferts sociaux observée pendant la même période. La concordance des courbes est assez étonnante. Le livre ayant été publié en 1986, reste cependant à savoir si cette concordance se poursuit - mais affectée d’un signe inverse - pour la période de désinflation dans laquelle on vit depuis. On peut assez logiquement penser que la déflation est plutôt favorable au resserrement des liens familiaux.
4.L’hypothèse libérale est qu’en matière d’action familiale - c'est à dire de soutien ou de prise en charge des familles les plus démunies ou en difficulté - l’initiative de la société civile devrait se suffire à elle-même. C’est tout le problème de l’action caritative privée qui est posé. Il est vrai qu’il existe des « externalités » qui font que, laissé aux seules initiatives privées, le marché ne produira pas un montant de transferts socialement « optimal » (problème de l’altruiste « esquiveur »). Mais rien ne dit que si l’on tient également compte des « défaillances » mises en lumière dans la production de transferts par le marché politique, celui-ci conduira nécessairement à un résultat social « meilleur ». Par ailleurs l’action des organismes publics se heurte au même problème de décentralisation dans la collecte du savoir et de l’information que celui mis en avant par Hayek pour illustrer les vertus du marché. Ce n’est pas parce qu’une administration se rapproche territorialement du citoyen qu’elle résout mieux qu’une administration centrale le problème de la dispersion de la connaissance. Tant l’observation de ce qui se pratiquait avant l’Etat-providence (dans les pays anglo-saxons) que la théorie comparative des institutions permettent de penser que si un libre marché de l’initiative caritative privée ne mènerait pas à l’optimal, on n’en serait pas nécessairement aussi éloigné qu’on aime généralement à le croire.
Cette confiance dans la société civile est évidemment typiquement anglo-saxonne. Elle s’appuie sur des faits historiques incontestables. En France, le débat est obscurci par la vieille querelle qui a opposé la République et l’Eglise pendant tout le dix-neuvième. Cette dernière étant monarchiste et légitimiste, alors même qu’elle « trustait » la plus grande part des activités caritatives de l’époque, il en est résulté une méfiance instinctive et profondément ancrée (confortée plus tard par l’utilisation « révolutionnaire » des associations syndicales) des institutions publiques françaises à l’encontre de toute liberté trop grande qui serait accordée aux initiatives de la société civile.
2
1 - La politique de la famille peut être vue soit comme un instrument visant à changer les comportements des gens dans un sens « pro-nataliste », soit comme un « faux nez » de la politique de redistribution au profit des familles les plus déshéritées (pour compenser les handicaps sociaux dont souffrent les enfants de ces familles). Toutes les politiques familiales marient plus ou moins les deux motivations.
2 - Je ne crois pas à l’argument nataliste. Après avoir passé au crible les études empiriques existantes, Bertrand Lemennicier (dans son livre paru il y a dix ans) est sceptique. La corrélation apparente entre la réduction du niveau des prestations familiales et la baisse de la natalité ne prouve rien. Cette corrélation peut être liée à bien d’autres facteurs : l’inflation des années 70/80 qui entraîne une forte augmentation des taux de divorce, la hausse des prélèvements fiscaux (qui peut notamment expliquer l’augmentation du taux d’activité féminin), la montée du chômage et la peur croissante de l’avenir... Les trésoreries des ménages sont fongibles. Rien ne garantit que l’argent des allocations familiales sert bien à financer les besoins spécifiques des enfants, et non pas les billets de PMU du père ou les cigarettes de la mère. Au nom de ce principe de fongibilité, les libéraux sont très critiques de toute subvention. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une sorte particulière de subvention qui, parce qu’elle est donnée au nom de la famille, échapperait à cette critique. Si toutes les subventions sont mauvaises, pourquoi l’une d’entre elles cesserait-elle soudainement de l’être ? Et si l’on fait une exception pour ce type de subvention, au nom de quoi refuser d’admettre l’argument des autres demandeurs de subventions qui ont toujours une bonne raison pour soutenir la légitimité de leur demande ? On tombe dans la subjectivité la plus grande.
3 - S’il y a un effet sur la natalité, celui-ci se concentre vraisemblablement sur certaines des couches les plus défavorisées de la population, là où les allocations familiales sont un complément qui permet de compenser l’insuffisance des revenus de survie (indemnités de chômage, RMI, ...). L’existence des allocations familiales est un facteur qui accroît la désincitation au travail des personnes actives ne pouvant prétendre à un salaire supérieur au SMIC. Elles encouragent le développement de modes de vie et de cohabitation marginaux, autour desquels prospèrent le travail au noir, l’économie parallèle et la délinquance. Ce faisant, elles contribuent à accroître la production d’enfants dans les milieux qui sont précisément les plus mal armés pour assurer l’éducation et l’intégration sociale de ces enfants. D’où, à nouveau, un besoin plus important de structures sociales d’aide et d’accueil pour s’occuper de cette jeunesse défavorisée. C’est ici que l’argument nataliste rejoint la dimension redistributrice de la politique familiale. Il s’agit en réalité de fabriquer de nouveaux clients pour ceux dont c’est le métier que de gérer et administrer tous ces budgets - qu’il s’agisse de fonctionnaires ou d’animateurs d’associations parties prenantes du vaste lobby familialiste et qui vivent de la redistribution d’argent pris par l’Etat.
4 - La remarque qui précède signifie que lorsqu’on parle de repenser l’ensemble des mécanismes de la redistribution sociale pour en supprimer les effets pervers (voir la tendance vers le « workfare », la recherche de mécanismes permettant d’effacer les effets de seuil, la réforme du SMIC, etc...), il ne faut pas oublier d’y inclure les allocations familiales qui, en réalité, font partie du même bloc. Celles-ci ne doivent pas être dissociées de l’ensemble du système de transferts sociaux sous prétexte qu’elles répondraient à un besoin « spécifique ».
5 - Partant de l’idée que les gens qui ont des enfants devraient bénéficier d’une retraite plus élevée, certains en concluent que « ceux qui investissent le plus dans l’éducation des futurs cotisants ont des droits à la retraite plus faibles ». Non, ils ont, dans le système actuel, des droits comme les autres. L’expression d’un souhait de type « utilitariste » - lier les retraites à la taille des familles pour encourager la natalité - ne permet pas d’en déduire qu’il y a une « injustice » au détriment de certaines familles. Ceux qui n’ont pas eu d’enfants investissent eux-aussi dans l’avenir, mais ils le font d’une manière différente. Rien ne permet de dire, indépendamment d’une connaissance subjective de l’environnement personnel de chaque individu, qu’une forme d’investissement est intrinsèquement meilleure ou moins bonne qu’une autre. Un tel jugement de valeur est une manifestation de pensée collectiviste. Celui qui n’a pas eu d’enfants n’est pas nécessairement un sale égoïste. Sa situation peut s’expliquer par des facteurs historiques propres à chacun sur lesquels on n’a pas le droit de porter de jugement de valeur. De ce que ceux qui n’ont pas d’enfants ne sont pas « pénalisés », on n’a pas le droit de conclure qu’ils sont actuellement « favorisés ». Là aussi c’est totalement contre-factuel et reflète simplement un jugement de valeur sur ce qui devrait être mis en place demain pour répondre à sa propre idée de la justice.
6 - La plupart des commentaires actuels sur la famille venant de la droite de l’échiquier politique reprennent en fait tous les préjugés d’une pensée conservatrice et « familialiste ». Ils expriment un parti-pris idéologique, politiquement correct, qui est certes honorable, mais n’exprime en rien une réflexion spécifiquement libérale. Ils succombent à toutes les ornières d’une pensée « constructiviste » qui néglige de tenir compte des effets de système qui font que l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Il s’agit incontestablement d’un domaine où la pensée libérale française manque d’une réflexion approfondie.
7 - L’idée qu’ont ait un devoir envers la société (c. à d. le devoir de faire des enfants) est une résurgence d’esprit collectiviste. On ne peut avoir de devoirs envers une entité abstraite, on ne peut avoir de devoirs qu’envers des individus qui ont des droits - que nous avons le devoir de respecter. Notre devoir est non pas envers la collectivité, mais uniquement envers l’Autre, en tant qu’individu auquel nous sommes liés par le respect de règles de comportement minimales nécessaires à une coexistence pacifique. Cette idée de devoir collectif nous fausse l’esprit en ce sens qu’elle nous porte à rechercher ce que nous (c’est à dire en réalité l’Etat) devrions faire pour obtenir des autres qu’ils se comportent comme nous pensons qu’il est de leur devoir de se comporter. On voit immédiatement où se niche la subjectivité. Ce faisant, notre esprit est détourné de ce qui devrait être notre seule sujet d’interrogation : rechercher ce qui fait que les familles ont moins d’enfants. Le rechercher non pas dans une sorte de culpabilité individuelle implicite, mais dans des facteurs objectifs qui expliqueraient que, toutes choses égales par ailleurs, les familles réduisent leur comportement procréateur.
8 -L’un des bons facteurs d’explication est sans doute la croissance de la fiscalité, avec deux effets : 1. la généralisation du travail des deux parents pour compenser les effets de l’impôt; 2. la réduction de l’épargne et donc du patrimoine que l’on laissera à sa descendance. Seuls des travaux empiriques peuvent nous donner la réponse.
9 - Accroître les transferts au bénéfice des familles implique que plus d’impôts soient pris quelque part. Donc qu’on en rajoute encore aux effets pervers des politiques de transferts. Le plus important est l’effet d’éviction que l’augmentation des prélèvements, en raison des taux atteints aujourd’hui, entraîne au niveau de l’épargne des ménages. L’épargne individuelle est remplacée par la bourse de l’Etat¬providence qui distribue aujourd’hui l’argent que les ménages auraient fait fructifier en le plaçant dans l’économie mondiale. La conséquence est, toutes choses égales par ailleurs, la diminution des transferts intergénérationnels privés (générateurs de richesses supplémentaires) remplacés par des transferts intergénérationnels publics financés par des prélèvements qu’il faudra encore accroître, et qui accentueront d’autant l’effet d’éviction. L’Etat-providence y gagne une raison d’être supplémentaire : demain il sera plus que jamais nécessaire pour apporter son filet de sécurité aux enfants qu’il a spolié de l’épargne accumulée qu’auraient pu leur transmettre leurs parents s’ils n’avaient été autant taxés. La logique de l’Etat-providence est celle de la dépendance accrue de couches de population toujours plus nombreuses.
10 - Nous vivons le moment crucial où deux logiques s’affrontent : celle du retour à des circuits de financement mondiaux permettant aux populations occidentales de reconstituer leur capacité ancienne d’épargne (avant l’Etat-providence qu’ont apporté les guerres et leurs destructions de capital); celle de la dépendance toujours plus accentuée à l’égard des transferts publics. La première est favorable à la famille et à l’esprit de procréation; la seconde détruit la famille et nous laisse devant l’angoissante question de savoir si un jour ce n’est pas l’Etat lui-même qui se trouvera contraint de faire le choix de produire des clones en grande série - au nom de ses impératifs « populationnistes ». De quelque côté qu’on le prenne, l’Etat-providence conduit toujours à Orwell !
11 - Le natalisme fait aujourd’hui l’objet d’un consensus quasi-total parmi les forces politiques. Mais il faut s’interroger sur sa raison d’être. Profondément, ce n’est que l’expression d’une considération financière, le fruit de notre panique devant la perspective de régimes de retraite qui ne seraient plus en mesure d’assurer nos vieux jours. Vite, vite... il faut faire des enfants pour qu’on nous paie nos retraites ! Et pour que les gens fassent plus d’enfants il faut leur donner davantage d’argent, en le prenant sur le dos de ceux qui n’en font pas (ou peu). Malheureusement, on retombe sur ce qui est dit plus haut. D’où va venir cet argent ? De plus d’impôts sur le plus grand nombre (ceux qui n’ont pas d’enfants, ou qui n’en ont plus à charge, et qui vont se retrouver avec un taux prélèvement encore accru). Or il y a de fortes raisons de penser que, dans nos sociétés occidentales, le niveau de plus en plus élevé des prélèvements obligatoires est précisément l’une des origines de la sous-natalité. Veux-t-on encore aggraver le mal ? La politique familiale pour des raisons financière n’est ainsi qu’un faux fuyant pour ne pas affronter le vrai problème : celui de la refonte de nos systèmes de retraite. Pour assurer l’avenir des retraites, la première chose à faire est de repenser tout le système de répartition et de faire résolument le choix de systèmes de capitalisation. Recréons les conditions pour que les gens aient vraiment l’envie et les moyens de se constituer un patrimoine. Non seulement ils ne seront plus inquiets pour leurs retraites, mais ils auront moins de raison d’avoir peur de faire des enfants.
En résumé : le problème n’est pas de chercher ce qu’il faudrait faire pour obtenir des ménages qu’ils fassent plus d’enfants, mais d’éliminer les éléments qui, toutes choses égales d’ailleurs, les ont conduit à adopter une attitude de plus en plus négative à l’égard de la procréation. Profitons des circonstances (le passage à un univers mondial sans inflation) pour faire d’une pierre deux coups : régler ensemble et le problème des retraites, et le problème de la natalité.