Pierre-Joseph Proudhon:Du principe fédératif
| Pierre-Joseph Proudhon | |
|---|---|
| 1809-1865 | |
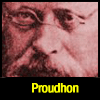
| |
| Auteur anarchiste | |
| Citations | |
| « Le gouvernement de l'homme par l'homme, c'est la servitude. » « Say est un génie » « Voilà donc tout mon système : liberté de conscience, liberté de la presse, liberté du travail, liberté de l'enseignement, libre concurrence, libre disposition des fruits de son travail, liberté à l'infini, liberté absolue, liberté partout est toujours ! C'est le système de 1789 et 1793 ; le système de Quesnay, de Turgot, de Jean-Baptiste Say (...) La liberté, donc, rien de plus, rien de moins. Le « laisser-faire, laissez-passer » dans l'acception la plus littérale et la plus large ; conséquemment, la propriété, en tant qu'elle découle légitimement de cette liberté : voilà mon principe. Pas d'autre solidarité entre les citoyens que celle des accidents de force majeure (...) C'est la foi de Franklin, Washington, Lafayette, de Mirabeau, de Casimir Périer, d'Odilon Barrot, de Thiers... » | |
| Galaxie liberaux.org | |
| Wikibéral | |
| Articles internes |
Position du problème politique. - Principe de solution
Si le lecteur a suivi avec quelque diligence l'exposition qui précède, la société humaine doit lui apparaître comme une création fantastique, pleine d'étonnements et de mystères. Rappelons-en brièvement les différents termes:
- 1. L'ordre politique repose sur deux principes connexes, opposés et irréductibles : l'Autorité et la Liberté.
- 2. De ces deux principes se déduisent parallèlement deux régimes contraires : le régime absolutiste ou autoritaire, et le régime libéral.
- 3. Les formes de ces deux régimes sont aussi différentes entre elles, incompatibles et inconciliables que leurs natures ; nous les avons définies en deux mots Indivision et Séparation.
- 4. Or, la raison indique que toute théorie doit se dérouler suivant son principe, toute existence se produire selon sa loi : la logique est la condition de la vie comme de la pensée. Mais c'est justement le contraire qui se manifeste en politique : ni l'Autorité ni la Liberté ne peuvent se constituer à part, donner lieu à un système qui soit exclusivement propre à chacune ; loin de là, elles sont condamnées, dans leurs établissements respectifs, à se faire de perpétuels et mutuels emprunts.
- 5. La conséquence est que la fidélité aux principes n'existant en politique que dans l'idéal, la pratique devant subir des transactions de toutes sortes, le gouvernement se réduit, en dernière analyse, malgré la meilleure volonté et toute la vertu du monde, à une création hybride, équivoque, à une promiscuité de régimes que la logique sévère répudie, et devant laquelle recule la bonne foi. Aucun gouvernement n'échappe à cette contradiction.
- 6. Conclusion : l'arbitraire entrant fatalement dans la politique, la corruption devient bientôt l'âme du pouvoir, et la société est entraînée, sans repos ni merci, sur la pente sans fin des révolutions.
Le monde en est là. Ce n'est l'effet ni d'une malice satanique, ni d'une infirmité de notre nature, ni d'une condamnation providentielle, ni d'un caprice de la fortune ou d'un arrêt du Destin : les choses sont ainsi, voilà tout. A nous de tirer le meilleur parti de cette situation singulière.
Considérons que depuis plus de huit mille ans, - les souvenirs de l'histoire ne remontent pas au delà, toutes les variétés de gouvernement, toutes les combinaisons politiques et sociales ont été successivement essayées, abandonnées, reprises, modifiées, travesties, épuisées, et que l'insuccès a constamment récompensé le zèle des réformateurs et trompé l'espérance des peuples. Toujours le drapeau de la liberté a servi à abriter le despotisme ; toujours les classes privilégiées se sont entourées, dans l'intérêt même de leurs privilèges, d'institutions libérales et égalitaires ; toujours les partis ont menti à leur programme, et toujours l'indifférence succédant à la foi, la corruption à l'esprit civique, les Etats ont péri par le développement des notions sur lesquelles ils s'étaient fondés. Les races les plus vigoureuses et les plus intelligentes se sont usées à ce travail : l'histoire est pleine du récit de leurs luttes. Quelquefois une suite de triomphes faisant illusion sur la force de l'Etat, on a pu croire à une excellence de constitution, à une sagesse de gouvernement qui n'existaient pas. Mais, la paix survenant, les vices du système éclataient aux yeux, et les peuples se reposaient dans la guerre civile des fatigues de la guerre du dehors. L'humanité est allée ainsi de révolution en révolution : les nations les plus célèbres, celles qui ont fourni la plus longue carrière, ne se sont soutenues que par là. Parmi tous les gouvernements connus et pratiqués ; jusqu'à ce jour, il n'en est pas un qui, s'il était condamné à subsister par sa vertu propre, vivrait âge d'homme. Chose étrange, les chefs d'États et leurs ministres sont de tous les hommes ceux qui croient le moins à la durée du système qu'ils représentent ; jusqu'à ce que vienne la science, c'est la foi des masses qui soutient les gouvernements. Les Grecs et les Romains, qui nous ont légué leurs institutions avec leurs exemples, parvenus au moment le plus intéressant de leur évolution, s'ensevelissent dans leur désespoir ; et la société moderne semble arrivée à son tour à l'heure d'angoisse. Ne vous fiez pas à la parole de ces agitateurs qui. crient, Liberté, Égalité, Nationalité : ils ne savent rien ; ce sont des morts qui ont la prétention de ressusciter des morts. Le public un instant les écoute, comme il fait les bouffons et les charlatans ; puis il passe, la raison vide et la conscience désolée.
Signe certain que notre dissolution est proche et qu'une nouvelle ère va s'ouvrir, la confusion du langage et des idées est arrivée au point que le premier venu peut se dire à volonté républicain, monarchiste, démocrate, bourgeois, conservateur, partageux, libéral, et tout cela à la fois, sans craindre que personne le convainque de mensonge ni d'erreur. Les princes et les barons du premier Empire avaient fait leurs preuves de sansculottisnte. La bourgeoisie de 1814, gorgée de biens nationaux, la seule chose qu'elle eût comprise des institutions de 89, était libérale, révolutionnaire même ; 1830 la refit conservatrice ; 1848 fa rendue réactionnaire, catholique, et plus que jamais monarchique. Actuellement ce sont les républicains de février qui servent la royauté de Victor-Emmanuel, pendant que les socialistes de juin se déclarent unitaires. D'anciens amis de Ledru-Rollin se rallient à l'Empire compte à la véritable expression révolutionnaire et à la forme la plus paternelle de gouvernement ; d'autres il est vrai les traitent de vendus, mais se déchaînent avec fureur contre le fédéralisme. C'est le gâchis systématique, la confusion organisée, l'apostasie en permanence, la trahison universelle.
Il s'agit de savoir si la société peut arriver à quelque chose de régulier, d'équitable et de fixe, qui satisfasse la raison et la conscience, ou si nous sommes condamnés pour l'éternité à cette roue d'Ixion. Le problème est-il insoluble ?... Encore un peu de patience, lecteur ; et si je ne vous fais tout à l'heure sortir de l'imbroglio, vous aurez le droit de dire que la logique est fausse, le progrès un leurre, et la liberté une utopie. Daignez seulement raisonner avec moi encore quelques minutes, bien qu'en pareille affaire raisonner soit s'exposer à se duper soi-même et à perdre sa peine avec sa raison.
- 1. Vous remarquerez d'abord que les deux principes, l'Autorité et la Liberté, de qui vient tout le mal, se montrent dans l'histoire en succession logique et chronologique. L'Autorité, comme la famille, comme le père, genitor, paraît la première : elle a l'initiative, c'est l'affirmation. La Liberté raisonneuse vient après : c'est la critique, la protestation, la détermination. Le fait de cette succession résulte de la définition même des idées et de la nature des choses, et toute l'histoire en rend témoignage. Là, pas d'inversion possible, pas le moindre vestige d'arbitraire.
- 2. Une autre observation non moins importante c'est que le régime autoritaire, paternel et monarchique s'éloigne d'autant plus de son idéal, que la famille, tribu ou cité devient plus nombreuse et que l'État grandit en population et en territoire : en sorte que plus l'autorité prend d'extension, plus elle devient intolérable. De là les concessions qu'elle est obligée de faire à la liberté. - Inversement, le régime de liberté s'approche d'autant plus de son idéal et multiplie ses chances de succès, que l'État augmente en population et en étendue, que les rapports se multiplient et que la science gagne du terrain. D'abord c'est une constitution qui de toutes parts est réclamée ; plus tard ce sera la décentralisation. Attendez encore, et vous verrez surgir l'idée de fédération. En sorte que l'on peut dire de la Liberté et de l'Autorité ce que Jean le Baptiseur disait de lui et de Jésus : Illam oportet crescere, hanc autem minui.
« le système fédératif est l'opposé de la hiérarchie ou centralisation administrative et gouvernementale par laquelle se distinguent, ex quo, les démocraties impériales, les monarchies constitutionnelles et les républiques unitaires. Sa loi fondamentale, caractéristique, est celle-ci : Dans la fédération, les attributs de l'autorité centrale se spécialisent et se restreignent, diminuent de nombre, d'immédiateté, et si j'ose ainsi dire d'intensité, à mesure que la Confédération se développe par l'accession de nouveaux États. Dans les gouvernements centralisés au contraire, les attributs du pouvoir suprême se multiplient, s'étendent et s'immédiatisent, attirent dans la compétence du prince les affaires des provinces, communes, corporations et particuliers, en raison directe de la superficie territoriale et du chiffre de population. De là cet écrasement sous lequel disparaît toute liberté, non seulement communale et provinciale, niais même individuelle et nationale. »
Ce double mouvement, l'un de rétrogradation, l'autre de progrès, et qui se résout en un phénomène unique, résulte également de la définition des principes, de leur position relative et de leurs rôles : ici encore nulle équivoque n'est possible, pas la moindre place à l'arbitraire. Le fait est d'évidence objective et de certitude mathématique ; c'est ce que nous appellerons une LOI.
- 3. La conséquence de cette loi, que l'on peut dire nécessaire, est elle-même nécessaire : c'est que le principe d'autorité paraissant le premier, servant de matière ou de sujet d'élaboration à la Liberté, à la raison et au droit, est peu à peu subordonné par le principe juridique, rationaliste et libéral ; le chef d'État, d'abord inviolable, irresponsable, absolu, comme le père dans la famille, devient justiciable de la raison, premier sujet de la loi, finalement simple agent, instrument ou serviteur de la Liberté ellemême.
Cette troisième proposition est aussi certaine que les deux premières, à l'abri de toute équivoque et contradiction, et hautement attestée par l'histoire. Dans la lutte éternelle des deux principes, la Révolution française, de même que la Réforme, apparaît comme une ère diacritique. Elle marque le moment où, dans l'ordre politique, la Liberté a pris officiellement le pas sur l'Autorité, de même que la Réforme avait marqué l'instant où, dans l'ordre religieux, le libre examen a pris l'emport sur la foi. Depuis Luther la croyance est devenue partout raisonneuse ; l'orthodoxie aussi bien que l'hérésie a prétendu conduire par la raison l'homme à la foi ; le précepte de saint Paul, rationabile sit obsequium vestrum, que votre obéissance soit raisonnable, a été largement commenté et mis en pratique; Rome s'est mise à discuter comme Genève ; la religion a tendu à se faire science ; la soumission à l'Église s'est entourée de tant de conditions et de réserves que, sauf la différence des articles de foi, il n'y a plus eu de différence entre le chrétien et l'incrédule. Ils ne sont pas de même opinion, voilà tout : du reste, pensée, raison, conscience chez tous deux se comportent de même. Pareillement, depuis la Révolution française, le respect de l'autorité a failli ; la déférence aux ordres du prince est devenue conditionnelle ; on a exigé du souverain des réciprocités, des garanties ; le tempérament politique a changé ;les royalistes les plus fervents, comme les barons de Jean-Sans-Terre, ont voulu avoir des chartes, et MM. Berryer, de Falloux, de Montalembert, etc., peuvent se dire aussi libéraux que nos démocrates. Chateaubriand, le barde de la Restauration, se vantait d'être philosophe et républicain ; c'était par un acte pur de son libre arbitre qu'il s'était constitué le défenseur de l'autel et du trône. On sait ce qu'il advint du catholicisme violent de Lamennais.
Ainsi, tandis que l'autorité périclite, de jour en jour plus précaire, le droit se précise, et la liberté, toujours suspecte, devient néanmoins plus réelle et plus forte.
L'absolutisme résiste de son mieux, mais s'en va ; il semble que la RÉPUBLIQUE toujours combattue, honnie, trahie, bannie, s'approche tous les jours. Quel parti allons-nous tirer de ce fait capital pour la constitution du gouvernement ?
Dégagement de l'idée de fédération
Puisque, dans la théorie et dans l'histoire, l'Autorité et la Liberté se succèdent comme par une sorte de polarisation ;
Que la première baisse insensiblement et se retire, tandis que la seconde grandit et se montre ;
Qu'il résulte de cette double marche une sorte de subalternisation en vertu de laquelle l'Autorité se met de plus en plus au droit de la Liberté
Puisqu'en autres termes le régime libéral ou contractuel l'emporte de jour en jour sur le régime autoritaire, c'est à l'idée de contrat que nous devons nous attacher comme à l'idée dominante de la politique.
Qu'entend-on d'abord par contrat ?
Le contrat, dit le Code civil, art. 1101, est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Art. 1102. - Il est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les outres.
Art. 1103. - II est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
Art. 1104. - Il est commutatif lorsque chacun des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. - Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Art. 1105. - Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
Art. 1106. - Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
Art. 1371. - On appelle quasi-contrats les faits volontaires de l'homme, dont il résulte en engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
A ces distinctions et définitions du Code, relatives à la forme et aux conditions des contrats, j'en ajouterai une dernière, concernant leur objet selon la nature des choses pour lesquelles on traite ou l'objet qu'on se propose, les contrats sont domestiques, civils, commerciaux ou politiques.
C'est de cette dernière espèce de contrat, le contrat politique, que nous allons nous occuper. La notion de contrat n'est pas entièrement étrangère au régime monarchique, pas plus qu'elle ne l'est à la paternité et à la famille. Mais, d'après ce que nous avons dit des principes d'autorité et de liberté et de leur rôle dans la formation des gouvernements, on comprend que ces principes n'interviennent pas de la même manière dans la formation du contrat politique ; qu'ainsi (obligation qui unit le monarque à ses sujets, obligation spontanée, non écrite, résultant de l'esprit de famille et de la qualité des personnes, est une obliga tion unilatérale, puisqu'en vertu du principe d'obéissance le sujet est obligé à plus envers le prince que celui-ci envers le sujet. La théorie du droit divin dit expressément que le monarque n'est responsable qu'envers Dieu. Il peut arriver même que le contrat de prince à sujet dégénère en un contrat de pure bienfaisance, lorsque, par l'ineptie ou l'idolâtrie des citoyens, le prince est sollicité à s'emparer de l'autorité et à se charger de ses sujets, inhabiles à se gouverner et à se défendre, comme un berger de son troupeau. C'est bien pis là où le principe d'hérédité est admis. Un conspirateur comme le duc d'Orléans, plus tard Louis XII, un parricide comme Louis XI, une adultère connue Marie Stuart, conservant, malgré leurs crimes, leur droit éventuel à la couronne. La naissance les rendant inviolables, on peut dire qu'il existe entre eux et les sujets fidèles du prince auquel ils doivent succéder, un quasi-contrat. En deux mots, par cela même que l'autorité est prépondérante, dans le système monarchique, le contrat n'est pas égal.
Le contrat politique n'acquiert toute sa dignité et sa moralité qu'à la condition 1° d'être synallagmatique et commutatif ; 2° d'être renfermé, quant à son objet, dans certaines limites : deux conditions qui sont censées exister sous le régime démocratique, mais qui, là encore, ne sont le plus souvent qu'une fiction. Peut-on dire que dans une démocratie représentative et centralisatrice, dans une monarchie constitutionnelle et censitaire, à plus forte raison dans une république communiste à la manière de Platon, le contrat politique qui lie le citoyen à l'État soit égal et réciproque ? Peut-on dire que ce contrat, qui enlève aux citoyens la moitié ou les deux tiers de leur souveraineté et le quart de leur produit, soit renfermé dans de justes bornes ? Il serait plus vrai de dire, ce que l'expérience confirme trop souvent, que le contrat, dans tous ces systèmes, est exorbitant, onéreux, puisqu'il est, pour une parte plus ou moins considérable, sans compensation ; et aléatoire, puisque l'avantage promis, déjà insuffisant, n'est pas même assuré.
Pour que le contrat politique remplisse la condition synallagmatique et commutative que suggère l'idée de démocratie ; pour que, se renfermant dans de sages limites, il reste avantageux et commode à tous, il faut que le citoyen en entrant dans l'association, 1° ait autant à recevoir de l'État qu'il lui sacrifie ; 2° qu'il conserve toute sa liberté, sa souveraineté et son initiative, moins ce qui est relatif à l'objet spécial pour lequel le contrai est formé et dont on demande la garantie à l'État. Ainsi réglé et compris, le contrat politique est ce que j'appelle une fédération.
FÉDÉRATION, du latin foedus, génitif foederis, c'est-à-dire pacte, contrat, traité, convention, alliance, etc., est une convention par laquelle un ou plusieurs chefs de famille, une ou plusieurs communes, un ou plusieurs groupes de communes ou États, s'obligent réciproquement et également les uns envers les autres pour un ou plusieurs objets particuliers, dont la charge incombe spécialement alors et exclusivement aux délégués de la fédération (1).
Revenons sur cette définition.
Ce qui fait l'essence et le caractère du contrat fédératif, et sur quoi j'appelle l'attention du lecteur, c'est que dans ce système les contractants, chefs de famille, commune, cantons, provinces ou États, non seulement s'obligent synallagmatiquement et commutativement les mis envers les autres, ils se réservent individuellement, en formant le pacte, plus de droits, de liberté, d'autorité, de propriété, qu'ils n'en abandonnent.
Il n'en est pas ainsi, par exemple, dans la société universelle de biens et des gains, autorisée par le Code civil, autrement dite communauté, image en miniature de tous les États absolus. Celui qui s'engage dans une association de cette espèce, surtout si elle est perpétuelle, est entouré de plus d'entraves, soumis à plus de charges qu'il ne conserve d'initiative. Mais c'est aussi ce qui fait la rareté de ce contrat, et ce qui dans tous les temps a rendu la vie cénobitique insupportable. Tout engagement, même synallagmatique et commutatif, qui, exigeant des associés la totalité de leurs efforts, ne laisse rien à leur indépendance et les dévoue tout entiers à l'association, est un engagement excessif, qui répugne également au citoyen et à l'homme.
D'après ces principes, le contrat de fédération ayant pour objet, en termes généraux, de garantir aux Étais confédérés leur souveraineté, leur territoire, la liberté de leurs citoyens ; de régler leurs différends ; de pourvoir, par des mesures générales, à tout ce qui intéresse la sécurité et la prospérité commune, ce contrat, dis-je, malgré la grandeur des intérêts engagés, est essentiellement restreint. L'Autorité chargée de son exécution ne peut jamais l'emporter sur ses constituantes, je veux dire que les attributions fédérales ne peuvent jamais excéder en nombre et en réalité celles des autorités communales ou provinciales, de même que celles-ci ne peuvent excéder les droits et prérogatives de l'homme et du citoyen. S'il en était autrement, la commune serait une communauté ; la fédération redeviendrait une centralisation monarchique ; l'autorité fédérale, de simple mandataire et fonction subordonnée qu'elle doit être, serait regardée comme prépondérante ; au lieu d'être limitée à un service spécial, elle tendrait à embrasser toute activité et toute initiative ; les États confédérés seraient convertis en préfectures, intendances, succursales ou régies. Le corps politique, ainsi transformé, pourrait s'appeler république, démocratie ou tout ce qu'il vous plaira : ce ne serait plus un État constitué dans la plénitude de ses autonomies, ce ne serait plus une confédération. La même chose aurait lieu, à plus forte raison, si, par une fausse raison d'économie, par déférence ou par toute autre cause, les communes, cantons ou États confédérés chargeaient l'un d'eux de l'administration et du gouvernement des autres. La république de fédérative deviendrait unitaire ; elle serait sur la route du despotisme (2).
En résumé, le système fédératif est l'opposé de la hiérarchie ou centralisation administrative et gouvernementale par laquelle se distinguent, ex quo, les démocraties impériales, les monarchies constitutionnelles et les républiques unitaires. Sa loi fondamentale, caractéristique, est celle-ci : Dans la fédération, les attributs de l'autorité centrale se spécialisent et se restreignent, diminuent de nombre, d'immédiateté, et si j'ose ainsi dire d'intensité, à mesure que la Confédération se développe par l'accession de nouveaux États. Dans les gouvernements centralisés au contraire, les attributs du pouvoir suprême se multiplient, s'étendent et s'immédiatisent, attirent dans la compétence du prince les affaires des provinces, communes, corporations et particuliers, en raison directe de la superficie territoriale et du chiffre de population. De là cet écrasement sous lequel disparaît toute liberté, non seulement communale et provinciale, niais même individuelle et nationale.
Une conséquence de ce fait, par laquelle je terminerai ce chapitre, c'est que, le système unitaire étant l'inverse du système fédératif, une confédération entre grandes monarchies, à plus forte raison entre démocraties impériales, est chose impossible. Des États comme la France, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse, peuvent faire entre eux des traités d'alliance ou de commerce ; il répugne qu'ils se fédéralisent, d'abord, parce que leur principe y est contraire, qu'il les mettrait en opposition avec le pacte fédéral ; qu'en conséquence il leur faudrait abandonner quelque chose de leur souveraineté, et reconnaître au-dessus d'eux, au moins pour certains cas, un arbitre. Leur nature est de commander, non de transiger ni d'obéir. Les princes qui, en 1813, soutenus par l'insurrection des masses, combattaient pour les libertés de l'Europe contre Napoléon, qui plus tard formèrent la Sainte-Alliance, n'étaient pas des confédérés : l'absolutisme de leur pouvoir leur défendait d'en prendre le titre. C'étaient, comme en 92, des coalisés ; l'histoire ne leur donnera pas d'autre nom. Il n'en est pas de même de la Confédération germanique, présentement en travail de réforme, et dont le caractère de liberté et de nationalité menace de faire disparaître un jour les dynasties qui lui font obstacle (3).
Constitution progressive
L'histoire et l'analyse, la théorie et l'empirisme, nous ont conduits, à travers les agitations de la Liberté et du Pouvoir, à l'idée d'un contrat politique.
Appliquant aussitôt cette idée et cherchant à nous en rendre compte, nous avons reconnu que le contrat social par excellence était un contrat de fédération, due nous avons défini en ces termes : Un contrat synallagmatique et commutatif, pour un ou plusieurs objets déterminés, mais dont fa condition essentielle est que les contractants se réservent toujours une part de souveraineté et d'action plus grande que celle qu'ils abandonnent.
Juste le contraire de ce qui a lieu dans les anciens systèmes, monarchiques, démocratiques et constitutionnels, où, par la force des situations et l'entraînement des principes, les particuliers et les groupes sont censés abdiquer entre les mains d'une autorité imposée ou élue leur souveraineté tout entière, et obtiennent moins de droits, conservent moins de garanties et d'initiative, qu'il ne leur incombe de charges et de devoirs.
Cette définition du contrat de fédération est un pas immense, qui va nous donner la solution tant cherchée.
Le problème politique, avons-nous dit Chap. Ier, ramené à son expression la plus simple, consiste à trouver l'équilibre entre deux éléments contraires, l'Autorité et la Liberté. Toute fausse balance se traduit immédiatement, pour l'Etat en désordre et ruine, pour les citoyens en oppression et misère. En autres termes, les anomalies ou perturbations de l'ordre social résultent de l'antagonisme de ses principes ; elles disparaîtront quand les principes seront coordonnés de telle sorte qu'ils ne se puissent plus nuire.
Équilibrer deux forces, c'est les soumettre à une loi qui, les tenant en respect l'une par l'autre, les mette d'accord. Qui va nous fournir ce nouvel élément, supérieur à l'Autorité et à la Liberté, et rendu par leur mutuel consentement la dominante du système ? - Le contrat, dont la teneur fait DROIT, et s'impose également aux deux puissances rivales (4).
Mais, dans une nature concrète et vivante, telle que la société, le Droit ne peut pas se réduire à une notion purement abstraite, aspiration indéfinie de la conscience, ce qui serait nous rejeter dans les fictions et les mythes. Il faut, pour fonder la société, poser non pas simplement une idée mais un acte juridique, former un vrai contrat. Les hommes de 89 le sentaient, quand ils entreprirent de donner à la France une Constitution, et tous les Pouvoirs qui leur ont succédé l'ont senti de même. Malheureusement, si la volonté était bonne, les lumières furent insuffisantes ; jusqu'ici le notaire a manqué pour rédiger le contrat. Nous savons quel en doit être l'esprit : tâchons maintenant d'en minuter la teneur.
Tous les articles d'une constitution peuvent se ramener à un article unique, celui qui concerne le rôle et la compétence de ce grand fonctionnaire qui a nom l'État. Nos assemblées nationales se sont occupées à l'envi de la distinction et de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire des facultés d'action de l'Etat ; quant à la compétence de l'Etat en elle-même, à son étendue, à son objet, on ne voit pas que personne s'en soit beaucoup inquiété. On a songé au partage, comme disait naïvement un ministre de 1848 ; quant à la chose à partager, il a paru généralement que plus il y en aurait, plus la fête serait belle. Et pourtant la délimitation du rôle de l'Etat est une question de vie ou de mort pour la liberté, collective et individuelle.
Le contrat de fédération, dont l'essence est de réserver toujours plus aux citoyens qu'à l'État, aux autorités municipales et provinciales plus qu'à l'autorité centrale, pouvait seul nous mettre sur le chemin de la vérité. Dans une société libre, le rôle de l'Etat ou Gouvernement est par excellence un rôle de législation, d'institution, de création, d'inauguration, d'installation ; c'est, le moins possible, un rôle d'exécution. A cet égard, le nom de pouvoir exécutif, par lequel on désigne un des aspects de la puissance souveraine, a singulièrement contribué à fausser les idées. L'Etat n'est pas un entrepreneur de services publics, ce qui serait l'assimiler aux industriels qui se chargent à forfait des travaux de la cité. L'État, soit qu'il édicte, soit qu'il agisse ou surveille, est le générateur et le directeur suprême du mouvement ; si parfois il met la main à la manoeuvre, c'est à titre de première manifestation, pour donner l'impulsion et poser un exemple. La création opérée, l'installation ou l'inauguration faite, l'Etat se retire, abandonnant aux autorités locales et aux citoyens l'exécution du nouveau service.
C'est l'Etat qui fixe les poids et mesures, qui donne le module, la valeur et les divisions des monnaies. Les types fournis, la première émission terminée, la fabrication des pièces d'or, d'argent et de cuivre cesse d'être une fonction publique, un emploi de l'État, une attribution ministérielle ; c'est une industrie laissée aux villes, et que rien. au besoin n'empêcherait, de même que la fabrication des balances, bascules, tonneaux et bouteilles, d'être tout à fait libre. Le meilleur marché est ici la seule loi. Qu'exige-t-on, en France, pour due la monnaie d'or et d'argent soit réputée d'aloi ? Un dixième d'alliage et neuf dixièmes de fin. Qu'il y ait un inspecteur pour suivre et surveiller la fabrication, je le veux : le rôle de l'Etat ne va pas au delà.
Ce que je dis des monnaies, je le redis d'une foule de services, abusivement laissés aux mains du gouvernement : routes, canaux, tabacs, postes, télégraphes, chemins de fer, etc. Je comprends, j'admets, je réclame au besoin l'intervention de l'Etat dans toutes ces grandes créations d'utilité publique ; je ne vois point la nécessité de les laisser sous sa main une fois qu'elles ont été livrées au public. Une semblable concentration, selon moi, constitue un véritable excès d'attributions. J'ai demandé, en 1848, l'intervention de l'Etat pour l'établissement de banques nationales, institutions de crédit, de prévoyance, d'assurance, comme pour les chemins de fer : jamais il n'est entré dans ma pensée que l'État, ayant accompli son oeuvre de création, dût rester à tout jamais banquier, assureur, transporteur, etc. Certes, je ne crois pas à la possibilité d'organiser l'instruction du peuple sans un grand effort de l'autorité centrale, mais je n'en reste pas moins partisan de la liberté de l'enseignement, comme de toutes les libertés (5). Je veux que l'école soit aussi radicalement séparée de l'État que l'Église elle-même. Qu'il y ait une Cour des comptes, de même qu'un bureau de statistique, établis pour rassembler, vérifier et généraliser toutes les informations, toutes les transactions, toutes les opérations de finance sur la surface de la République, à la bonne heure. Mais pourquoi toutes les dépenses et recettes passeraient-elles par les mains d'un trésorier, receveur ou payeur unique, ministre d'État, quand l'État, par la nature de sa fonction, ne doit avoir que peu ou point de service à faire, partant peu ou point de dépenses (6) ?... Est-ce qu'il est vraiment nécessaire aussi que les tribunaux soient dépendants de l'autorité centrale ? Rendre la justice fut de tout temps la plus haute attribution du prince, je le sais : mais cette attribution est un reste de droit divin ; elle ne saurait être revendiquée par un roi constitutionnel, à plus forte raison par le chef d'un empire établi sur le suffrage universel. Du moment donc que l'idée du Droit, redevenant humaine, obtient comme telle la prépondérance dans le système politique, l'indépendance de la magistrature en sera la conséquence nécessaire. Il répugne que la Justice soit considérée comme un attribut de l'autorité centrale ou fédérale ; elle ne peut être qu'une délégation faite par les citoyens à l'autorité municipale, tout au plus à la provinciale. La Justice est l'attribut de l'homme, qu'aucune raison d'État ne doit en dépouiller. - Je n'excepte pas même le service de guerre de cette règle : les milices, les magasins, les forteresses, ne passent aux mains des autorités fédérales que dans les cas de guerre et pour l'objet spécial de la guerre ; hors de là, soldats et armements restent sous la main des autorités locales (7).
Dans une société régulièrement organisée, tout doit être en croissance continue, science, industrie, travail richesse, santé publique ; la liberté et la moralité doivent aller du même pas. Là, le mouvement, la vie, ne s'arrêtent pas un instant. Organe principal de ce mouvement, l'État est toujours en action, car il a sans cesse de nouveaux besoins à satisfaire, de nouvelles questions à résoudre. Si sa fonction de premier moteur et de haut directeur est incessante, ses oeuvres, en revanche, ne se répètent pas. Il est la plus haute expression du progrès. Or, qu'arrive-t-il lorsque, comme nous le voyons presque partout, comme on l'a vu presque toujours, il s'attarde dans les services qu'il a lui-même créés et cède à la tentation de l'accaparement ? De fondateur il se fait manoeuvre ; il n'est plus le génie de la collectivité, qui la féconde, la dirige et l'enrichit, sans lui imposer aucune gêne : c'est une vaste compagnie anonyme, aux six cent mille employés et aux six cent mille soldats, organisée pour tout faire, et qui, au lieu de venir en aide à la nation, au lieu de servir les citoyens et les communes, les dépossède et les pressure. Bientôt la corruption, la malversation, le relâchement entrent dans ce système ; tout occupé de se soutenir, d'augmenter ses prérogatives, de multiplier ses services et de grossir son budget, le Pouvoir perd de vue son véritable rôle, tombe dans l'autocratie et l'immobilisme ; le corps social souffre, et la nation, à rebours de sa loi historique, commence à déchoir.
N'avons-nous pas fait remarquer, Chap. VI, que dans l'évolution des Etats, l'Autorité et la Liberté sont en succession logique et chronologique ; que, de plus, la première est en décroissance continue, la seconde en ascension ; que le Gouvernement, expression de l'Autorité, est insensiblement subalternisé par les représentants ou organes de la Liberté, savoir : le Pouvoir central par les députés des départements ou provinces; l'autorité provinciale par les délégués des communes, et l'autorité municipale par les habitants ; qu'ainsi la liberté aspire à se rendre prépondérante, l'autorité à devenir servante de la liberté, et le principe contractuel à se substituer partout, dans les affaires publiques, au principe autoritaire ?
Si ces faits sont vrais, la conséquence ne peut être douteuse : c'est que, d'après la nature des choses et le jeu des principes, l'Autorité devant être en retraite et la Liberté marcher sur elle, mais de manière que les deux se suivent sans se heurter jamais, la constitution de la société est essentiellement progressive, ce qui signifie de plus en plus libérale, et que cette destinée ne peut être remplie que dans un système où la hiérarchie gouvernementale, au lieu d'être posée sur son sommet, soit établie carrément sur sa baste, je veux dire dans le système fédératif.
Toute la science constitutionnelle est là : je la résume en trois propositions :
- 1. Former des groupes médiocres, respectivement souverains, et les unir par un pacte de fédération ;
- 2. Organiser en chaque État fédéré le gouvernement d'après la loi de séparation des organes ; - je veux dire: séparer dans le pouvoir tout ce qui peut être séparé, définir tout ce qui peut être défini, distribuer entre organes ou fonctionnaires différents tout ce qui aura été séparé et défini ; ne rien laisser dans l'indivision ; entourer l'administration publique de toutes les conditions de publicité et de contrôle ;
- 3. Au lieu d'absorber les États fédérés on autorités provinciales et municipales dans une autorité centrale, réduire les attributions de celle-ci à un simple rôle d'initiative générale, de garantie mutuelle et de surveillance, dont les décrets ne reçoivent leur exécution que sur le visa des gouvernements confédérés et par des agents à leurs ordres, comme, dans la monarchie constitutionnelle, tout ordre émanant du roi doit, pour recevoir son exécution, être revêtu du contre-seing d'un ministre.
Assurément, la séparation des pouvoirs, telle qu'elle se pratiquait sous la Charte de 1830, est une belle institution et de haute portée, mais qu'il est puéril de restreindre aux membres d'un cabinet. Ce n'est pas seulement entre sept ou huit élus, sortis d'une majorité parlementaire, et critiqués par une minorité opposante, que doit être partagé le gouvernement d'un pays, c'est entre les provinces et les communes : faute de quoi la vie politique abandonne les extrémités pour le centre, et le marasme gagne la nation devenue hydrocéphale.
Le système fédératif est applicable à toutes les nations et à toutes les époques, puisque l'humanité est progressive dans toutes ses générations et dans toutes ses races, et que la politique de fédération, qui est par excellence la politique de progrès, consiste à traiter chaque population, à tel moment que l'on indiquera, suivant un régime d'autorité et de centralisation décroissantes, correspondant à l'état des esprits et des moeurs.
Notes
(1) Dans la théorie de J.-J. Rousseau, qui est celle de Robespierre et des Jacobins, le Contrat social est une fiction de légiste, imaginée pour rendre raison, autrement que par le droit divin, l'autorité paternelle ou la nécessité sociale, de la formation de l'État et des rapports entre le gouvernement et les individus. Cette théorie, empruntée aux calvinistes, était en 1764 un progrès, puisqu'elle avait pour but de ramener à une loi de raison ce qui jusque-là avait été considéré comme une appartenance de la loi de nature et de la religion. Dans le système fédératif, le contrat social est plus qu'une fiction ; c'est un pacte positif, effectif, qui a été réellement proposé, discuté, voté, adopté, et qui se modifie régulièrement à la volonté des contractants. Entre le contrat fédératif et celui de Rousseau et de 93, il y a toute la distance de la réalité à l'hypothèse.
(2) La Confédération helvétique se compose de vingt-cinq États souverains (dix-neuf cantons et six demi-cantons), pour une population de deux millions quatre centre mille habitants. Elle est donc régie par vingt-cinq constitutions, analogues à nos chartes on constitutions de 1791, 1793, 1795, 1799, 1814, 1830, 1848, 1852, plus une constitution fédérale, dont naturellement nous ne possédons pas, en France, l'équivalent. L'esprit de cette constitution, conforme aux principes posés ci-dessus, résulte des articles suivants :
« Art. 2. La confédération a pour but d'assurer l'indépendance de a la patrie contre l'étranger, de maintenir la tranquillité et 1'ordre à l'intérieur de protéger la liberté et les droits des confédérés, et d'accroître leur prospérité commune. »
« Art. 3. Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté e n'est pas limitée par la souveraineté fédérale et comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral. »
« Art. 5. La confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l'art. 3, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constituationnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que a le peuple a conférés aux autorités. »
Ainsi une confédération n'est pas précisément un État : c'est un groupe d'États souverains et indépendants, ligués par un pacte de garantie mutuelle. Une constitution fédérale n'est pas non plus ce que l'on entend en France par charte ou constitution, et qui est l'abrégé du droit public du pays ; c'est le pacte qui contient les conditions de la ligue, c'est-à-dire les droits et obligations réciproques des États. Ce que l'on appelle Autorité fédérale, enfin, n'est pas davantage un gouvernement ; c'est une agence créée par les États, pour l'exécution en commun de certains services dont chaque État se dessaisit, et qui deviennent ainsi attributions fédérales.
En Suisse, l'Autorité fédérale se compose d'une Assemblée délibérante élue par le peuple des vingt-deux cantons, et d'un Conseil exécutif composé de sept membres nommés par l'Assemblée. Les membres de l'Assemblée et du Conseil fédéral sont nommés pour trois ans ; la constitution fédérale pouvant être révisée en tout temps, leurs attributions sont, comme leurs personnes, révocables. En sorte que le Pouvoir fédéral est dans toute la force du mot, un mandataire placé sons la main de ses commettants, et dont le pouvoir varie à leur gré.
(3) Le droit public fédératif soulève plusieurs questions difficiles. Par exemple, un État à esclaves peut-il faire partie d'une confédération ? Il semble que non, pas plus qu'un État absolutiste : l'esclavage d'une partie de la nation étant la négation même du principe fédératif. Sous ce rapport, les Etats-Unis du Sud seraient d'autant mieux fondés à demander la séparation qu'il n'entre pas dans l'intention de ceux du Nord d'accorder, au moins de sitôt, aux Noirs émancipés, la jouissance des droits politiques. Cependant nous voyons que Washington, Madison et les autres fondateurs de 1'Union n'ont pas été de cet avis ; ils ont admis au pacte fédéral les États à esclaves. Il est vrai aussi que nous voyons en ce moment ce pacte contre nature se déchirer, et les États du Sud, pour conserver leur exploitation, tendre à une constitution unitaire, pendant que ceux du Nord, pour maintenir l'union, décrètent la déportation des esclaves.
La constitution fédérale Suisse, réformée en 1848, a décidé la question dans le sens de l'égalité ; son article 4 porte : « Tous a les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, a ni privilèges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles ». De la promulgation de cet article, qui a purgé la Suisse de tout élément aristocratique, date la vraie constitution fédérale helvétique.
En cas d'opposition entre les intérêts, la majorité confédérée peut-elle opposer à la minorité séparatiste l'indissolubilité du pacte? La négative a été soutenue en 1846 par le Sunderbund contre la majorité helvétique ; elle l'est aujourd'hui par les confédérés du Sud de l'Union américaine contre les fédéraux du Nord. Pour moi, je crois que la séparation est de plein droit, s'il s'agit d'une question de souveraineté cantonale laissée en dehors du pacte fédéral. Ainsi il ne m'est pas démontré que la majorité suisse aut puisé son droit contre le Sunderbunddans le pacte : la preuve, c'est qu'en 1848 la constitution fédérale a été réformée, précisément en vue du litige qui avait amené la formation du Sunderbund. Mais il peut arriver, par les considérations de commodo et incommodo, que les prétentions de la minorité soient incompatibles avec les besoins de la majorité, que de plus la scission compromettre la liberté des États : dans ce cas la question se résout par le droit de la guerre, ce qui veut dire que la partie la plus considérable, celle dont la ruine entraînerait le plus grand dommage, doit l'emporter sur la plus faible. C'est ce qui a eu lieu en Suisse et qui pourrait également se pratiquer aux États-Unis, si, aux États-Unis comme en Suisse, il ne s'agissait que d'une interprétation ou d'une application meilleure des principes du pacte, comme d'élever progressivement la condition des Noirs au niveau de celle des Blancs. Malheureusement le message de M. Lincoln ne laisse aucun doute à ce sujet. Le Nord pas plus que le Sud n'entend parler d'une émancipation véritable, ce qui rend la difficulté insoluble, même par la guerre, et menace d'anéantir la confédération.
Dans la monarchie, toute justice émane du roi : dans une confédération, elle émane, pour chaque État, exclusivement de ses citoyens. L'institution d'une haute cour fédérale serait donc, en principe, une dérogation au pacte. Il en serait de même d'une Cour de cassation, puisque, chaque État étant souverain et législateur, les législations ne sont pas uniformes. Toutefois, comme il existe des intérêts fédéraux et des affaires fédérales; comme il peut être commis des délits et des crimes contre la confédération, il y a, pour ces cas particuliers, des tribunaux fédéraux et une justice fédérale.
(4) Il y a trois manières de concevoir la loi, selon le point de vue où se place l'être moral et la qualité qu'il prend lui-même, comme croyant, comme philosophe et comme citoyen.
La loi est le commandement intimé à l'homme au nom de Dieu par une autorité compétente : c'est la définition de la théologie et du droit divin.
La loi est l'expression du rapport des choses : c'est la définition du philosophe, donnée par Montesquieu.
La loi est le statut arbitral de la volonté humaine (De la Justice dans la Révolution et dans l'Église, 8° Étude) : c'est la théorie du contrat et de la fédération.
La vérité étant une, bien que d'aspect variable, ces trois définitions rentrent l'une dans l'autre et doivent être regardées au fond comme identiques. Mais le système social qu'elles engendrent n'est pas le même : par la première, l'homme se déclare sujet de la loi et de son auteur ou représentant ; par la seconde, il se reconnaît partie intégrante d'un vaste organisme ; par la troisième, il fait la loi sienne et s'affranchit de toute autorité, fatalité et domination. La première formule est celle de l'homme religieux ; la seconde celle du panthéiste ; la troisième celle du républicain. Celle-ci seule est compatible avec la liberté.
(5) D'après la constitution fédérale suisse de 1848, la Confédération a le droit de créer une Université suisse. Cette idée fut énergiquement combattue comme attentatoire à la souveraineté des cantons, et selon moi c'était de bonne politique. J'ignore s'il a été donné suite nu projet.
(6) En Suisse, il existe un budget fédéral, administré par le Conseil fédéral, mais qui ne concerne que les affaires de la Confédération, et n'a rien de commun avec le budget des cantons et des villes.
(7) Constitution fédérale Suisse, art. 13. - « La Confédération n'a a pas le droit d'entretenir des armées permanentes. » - Je donne à méditer cet article à nos républicains unitaires.
| Accédez d'un seul coup d’œil aux articles consacrés à Pierre-Joseph Proudhon sur Catallaxia. |